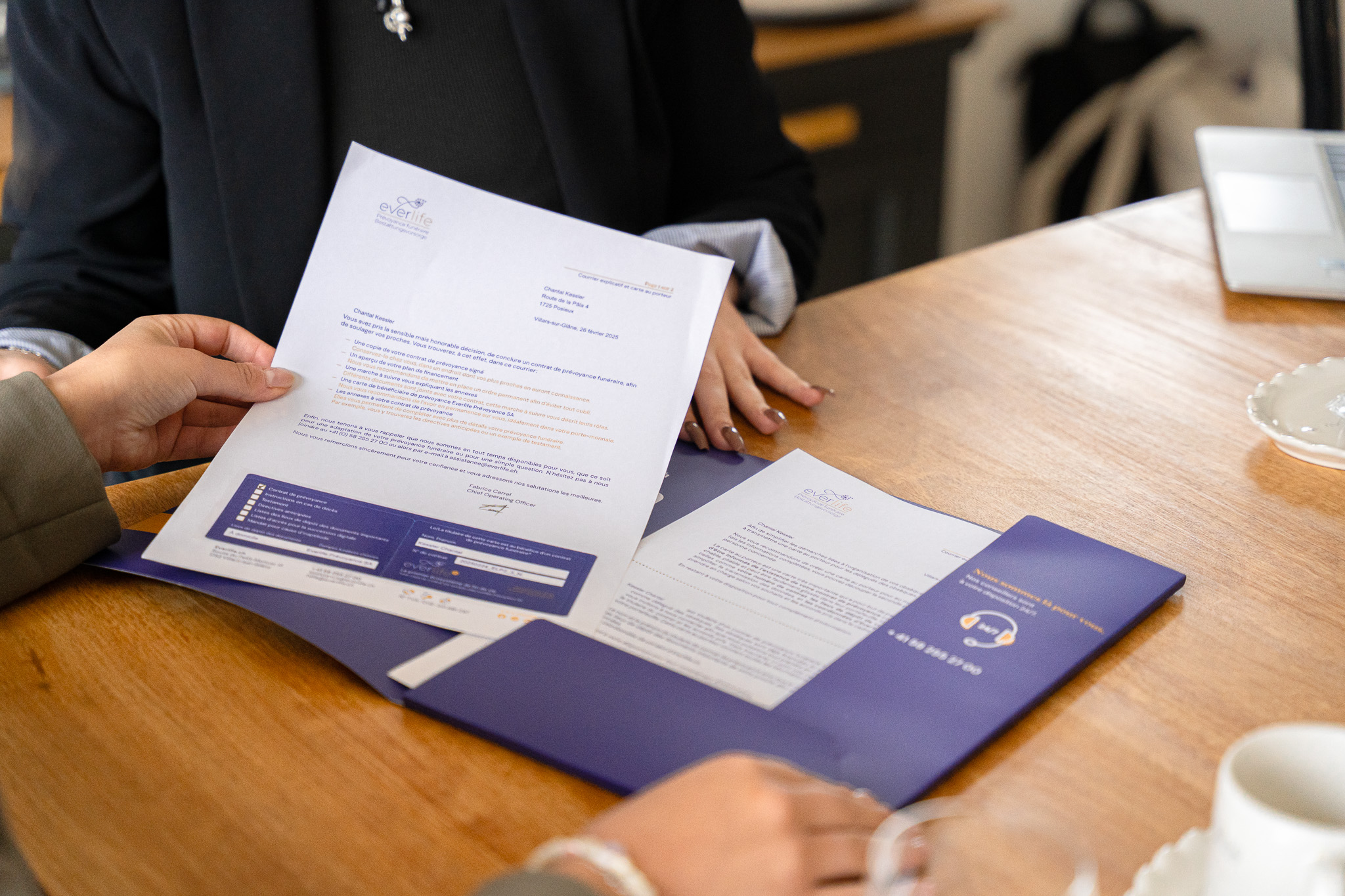En Suisse, on estime que plus de 70% des successions s'ouvrent sans testament ni dispositions formelles, plongeant les héritiers dans le cadre légal complexe de la succession ab intestat.
Cette situation soumet les héritiers à l'ordre successoral prévu par la loi. Si ce mécanisme légal garantit une distribution équitable selon des principes établis, il engendre souvent des démarches administratives plus lourdes, des délais allongés et, parfois, des conflits au sein même de la famille.
L'ordre de succession légal : une hiérarchie stricte
En Suisse, le Code civil suisse et les codes civils cantonaux établissent un ordre de succession précis en l'absence de testament ou de pacte successoral. Les enfants légitimes et les enfants adoptés occupent la première position dans l'ordre successoral. Ils héritent conjointement et par parts égales de la succession. Ainsi, si une personne sans testament décède en laissant trois enfants et un patrimoine de 300 000 francs suisses, chaque enfant recevra 100 000 francs, avant même que ne soit établi le reste du partage. Cette règle s'applique uniformément en Suisse alémanique, romande et tessinoise.
Si le défunt n'avait pas d'enfants, la succession passe à la deuxième parentèle, qui comprend le père et la mère du décédé ainsi que leurs descendants. En l'absence de parents vivants, les frères et sœurs du défunt, ou leurs enfants en cas de prédécès, héritent de la totalité du patrimoine. Ce mécanisme continue de manière successive jusqu'aux degrés plus éloignés de parenté.
Cas spécifique : la dévolution à l'État. Si le défunt ne laisse aucun héritier légal issu des trois parentèles (descendants, parents/frères/sœurs, grands-parents/oncles/tantes) et qu'il n'a pas de conjoint, la succession est dévolue à l'État. Elle revient au canton du dernier domicile du défunt ou à la Confédération si le domicile ne peut être établi (Art. 466 CC).
En matière de droits du conjoint, le cadre accorde au mari ou à la femme survivant une position particulière. Selon qu'il existe ou non des enfants, le conjoint reçoit soit la moitié de la succession (en présence d'enfants), soit les trois quarts (en l'absence d'enfants mais en présence de parents du défunt). Cette protection du conjoint a été renforcée lors de la révision du droit successoral entrée en vigueur au 1er janvier 2023, qui a supprimé les héritiers réservataires de la deuxième parentèle, notamment les parents, permettant une plus grande liberté de disposer en faveur du conjoint. La part réservataire des enfants reste fixée à la moitié de leur part héréditaire légale, ce qui a pour conséquence que la quotité disponible (la partie dont le défunt peut librement disposer par testament) représente désormais au minimum la moitié de la succession en toute hypothèse.
Les conséquences administratives et financières
L'absence de testament entraîne des conséquences concrètes qui affectent directement les héritiers et la gestion du patrimoine décédé. La première de ces conséquences est l'intervention obligatoire d'une autorité officielle, généralement l'office des successions cantonal ou un notaire mandaté par le tribunal. Alors qu'une succession testamentaire peut, dans certains cantons et selon certaines conditions, être exécutée de manière relativement simple entre héritiers consentants, une succession ab intestat requiert une reconnaissance officielle de l'ordre successoral.
Dès la connaissance du décès, l'autorité compétente du dernier domicile du défunt établit un inventaire conservatoire pour déterminer la masse successorale, soit l'ensemble des biens du défunt moins les dettes. Les héritiers légaux doivent alors décider s'ils acceptent ou refusent la succession dans un délai précis.
Cette reconnaissance implique des frais administratifs qui réduisent d'autant le patrimoine à distribuer aux héritiers. Ces frais, appelés émoluments, sont établis selon des tarifs réglementés qui varient d'un canton à l'autre et réduisent de facto le patrimoine distribué.
Le délai de traitement s'allonge également de manière significative. Alors qu'une succession avec testament peut être liquide et liquidée en trois à six mois selon la complexité des actifs, une succession sans testament nécessite généralement entre six et dix-huit mois. Ce délai plus long s'explique par les vérifications administratives supplémentaires, la recherche d'héritiers potentiels et, le cas échéant, les démarches de publication au journal officiel pour s'assurer qu'aucun héritier n'a été oublié.
Les impôts de succession, connus en Suisse sous le nom de « droits de succession », constituent un autre élément financier à considérer. Ces droits varient de manière substantielle selon le canton et le degré de parenté avec le défunt. Le canton de Genève accorde une exonération totale aux conjoints survivants et aux descendants en ligne directe. Pour les autres catégories d'héritiers, les droits varient selon le degré de parenté, avec des taux pouvant atteindre 23 % pour les frères et sœurs et 28 % pour les neveux et nièces.
À l'inverse, les cantons de Vaud, Valais et Neuchâtel appliquent une exonération pour les descendants et conjoints, avec des nuances importantes. Le canton de Vaud accorde depuis le 1er janvier 2025 une exonération jusqu'à 1 million de francs pour chaque enfant par souche héréditaire, tandis que le Valais exonère complètement les descendants directs et le conjoint non séparé. Neuchâtel applique un taux progressif pour les descendants selon le montant hérité.
Les tensions familiales et les complications pratiques
L'une des conséquences les plus délicates d'une succession sans testament concerne les tensions qui peuvent surgir entre les héritiers. Bien que la loi établisse un ordre de succession clair, son application peut engendrer des situations conflictuelles lorsque les intérêts divergent.
Prenons un exemple concret : une femme veuve décède en Valais sans avoir rédigé de testament. Elle laisse derrière elle deux enfants adultes et un bien immobilier estimé à 800 000 francs ainsi que diverses économies. Selon la loi, chaque enfant hérite de 400 000 francs. Or, l'un des enfants réside dans la maison depuis vingt ans et souhaite la conserver pour y élever sa propre famille, tandis que l'autre demande une compensation financière importante. Cette situation crée immédiatement un conflit : comment liquider le patrimoine de manière équitable sans contraindre le premier enfant à vendre la maison ou sans ruiner financièrement le second ? Le choix entre maintenir l'indivision ou procéder au partage de la succession devient une source de litige qui peut nécessiter un recours judiciaire.
Dans ce type de conflit immobilier, les héritiers peuvent demander à être désintéressés en numéraire, ou bien l'un d'eux peut demander l'attribution de la maison en propriété, souvent par rachat de la part de l'autre à la valeur vénale (valeur de marché).
Ces dilemmes pratiques se multiplient dans les successions complexes. Lorsqu'une entreprise familiale est impliquée, par exemple une petite manufacture genevoise exploitée depuis trois générations, l'absence de testament rend la continuation de l'activité extrêmement problématique. Les héritiers qui ne souhaitent pas continuer l'exploitation réclament leur part en numéraire, forçant parfois la vente précipitée de l'entreprise à des tiers ou sa liquidation. Cette situation aurait pu être évitée grâce à un testament ou un pacte successoral décrivant précisément le devenir de l'entreprise et les compensations à verser aux autres héritiers.
L'absence de testament peut également révéler ou aggraver des tensions familiales, notamment en cas de régimes matrimoniaux complexes ou si l'un des enfants est adopté. Le partage reposant uniquement sur la loi, la volonté du défunt de reconnaître ou protéger spécifiquement certains proches fait défaut.
Les créanciers du défunt représentent aussi un élément de complication supplémentaire. Une succession sans testament doit préalablement apurer toutes les dettes de la personne décédée avant distribution aux héritiers. Si cette succession se révèle surendettée, les héritiers légaux doivent décider collectivement s'ils acceptent purement et simplement la succession ou s'ils la renoncent. Cette décision, qui doit intervenir dans des délais précis définis par la loi cantonale, engage leur responsabilité financière personnelle. Il convient de noter que certaines institutions financières, comme les établissements bancaires, peuvent également tenir compte de produits d'assurance-vie lors du calcul de la fortune transmise, même si ces sommes ne font pas strictement partie de la masse successorale selon le Code civil suisse (voir art. 475 et suivants du Code civil suisse). Une attention particulière doit être portée aux comptes conjoints et au domicile effectif du défunt pour déterminer la juridiction compétente.
La sécurité et les simplifications potentielles du cadre légal ab intestat
Bien que dans la plupart des cas une succession sans testament soit génératrice de complications, elle présente paradoxalement quelques avantages dans des situations particulières. Premièrement, l'ordre successoral légal offre une certitude absolue quant aux droits de chacun.
De plus, pour les successions modestes et les familles sans contentieux prévisible, l'absence de testament peut accélérer les démarches dans certains cantons. Certains offices des successions proposent des procédures simplifiées pour les patrimoines inférieurs à un seuil donné, souvent situé entre 50 000 et 100 000 francs selon le canton. Dans ces cas, les frais administratifs diminuent sensiblement et les héritiers consentants peuvent obtenir une liquidation plus rapide sans devoir passer par un officier public ou un notaire.
L'ordre légal de succession protège aussi, de fait, les enfants du défunt en leur garantissant une part minimale de succession que seul un testament exceptionnel pourrait réduire. Cette protection, inscrite dans le concept des réserves héréditaires, signifie qu'aucun testament ne peut totalement déshériter un enfant sans respecter leur part réservataire, actuellement fixée à la moitié de leur part héréditaire légale. Inversement, un proche qui n'est pas un héritier légal, un ami de longue date ou un partenaire non marié ne peut rien recevoir en vertu de la loi, ce qui évite certaines formes de manipulation ou de contestation autour de promesses faites au défunt. La limite posée par la réserve protège ainsi la transmission du patrimoine familial au sein de la parenté directe.
Perspectives et enjeux futurs
Le cadre juridique suisse des successions sans testament évolue progressivement pour s'adapter aux réalités familiales contemporaines. L'une des tendances majeures concerne la reconnaissance croissante des couples non mariés et des partenariats enregistrés. Jusqu'à récemment, seul le mariage conférait des droits de succession. Depuis la révision du droit du mariage et du partenariat enregistré, les partenaires enregistrés jouissent de droits successoraux similaires aux époux. Toutefois, les couples vivant en concubinage n'ont toujours aucun droit légal de succession, ce qui constitue une lacune majeure pour les générations plus jeunes.
Cette absence de droit légal signifie qu'un concubin survivant ne peut hériter que de la quotité disponible (la part non réservée aux descendants ou conjoint). De plus, n'étant pas un héritier légal, il est souvent lourdement taxé par les droits de succession cantonaux, qui peuvent s'élever à plus de 30% dans certains cantons. L'établissement d'un testament est donc d'une importance capitale pour les concubins.
Cette question de l'intégration des couples sans mariage dans l'ordre de succession fait l'objet de débats publics croissants. Certains experts du droit suisse préconisent une évolution législative qui accorderait au moins une protection minimale aux partenaires de facto, particulièrement lorsqu'ils ont cohabité durant des périodes prolongées. Cette modification pourrait intervenir lors de futures révisions du droit successoral et toucherait des dizaines de milliers de ménages suisses.
Parallèlement, la question de la numérisation des successions gagne en pertinence. Plusieurs cantons expérimentent actuellement des registres de testaments numériques et des plateformes d'administration des successions en ligne. Ces initiatives pourraient, à terme, faciliter le repérage de testaments et réduire les délais de traitement des successions. L'existence de ces outils pourrait indirectement encourager les citoyens à rédiger un testament plutôt que de se fier au régime ab intestat.
Les démarches essentielles lors d'une succession sans testament :
- Déclaration du décès : annoncer le décès aux autorités compétentes du dernier domicile du défunt dans les délais légaux
Établissement de l'inventaire conservatoire : L'autorité ou le notaire dresse la liste complète des biens et dettes du défunt pour déterminer la masse successorale - Identification des héritiers légaux : vérification de l'ordre successoral applicable selon le Code civil suisse et recherche des éventuels héritiers
- Délai de réflexion : les héritiers disposent d'un délai cantonal (généralement trois mois) pour accepter ou refuser la succession
- Liquidation du régime matrimonial : si le défunt était marié, détermination de la part revenant au conjoint survivant selon le contrat de mariage
- Paiement des dettes et impôts : règlement des créanciers et des droits de succession avant distribution aux héritiers
Partage final : répartition des biens entre les héritiers selon leurs parts héréditaires légales, soit à l'amiable soit par décision judiciaire en cas de litige
Enfin, la question de la formation et de la sensibilisation du public à l'importance de la planification successorale demeure centrale. Actuellement, la proportion de Suisses ayant rédigé un testament ou conclu un pacte successoral reste relativement faible, estimée entre 15 et 25 % selon les régions. Cette sous-utilisation du testament, combinée à une méconnaissance des conséquences pratiques d'une succession sans testament, perpétue une situation qui génère chaque année des complications évitables pour des milliers de familles.
En bref
Pour les citoyens disposant d'un patrimoine, même modeste, ou d'une situation familiale complexe, la rédaction d'un testament reste l'option la plus prudente. Elle offre la certitude que les volontés du défunt seront respectées et facilite considérablement le travail des héritiers endeuillés.
L'absence de testament n'est jamais qu'une décision reportée, dont d'autres devront supporter les conséquences. Rédiger un testament permet de décider librement de l'attribution de sa fortune dans les limites de la quotité disponible, de modifier ses dispositions à tout moment, de désigner un bénéficiaire spécifique pour certains biens, de laisser des legs particuliers ou même d'instituer une fondation d'utilité publique. Quant à la forme : testament olographe, public ou authentique, c'est à vous de voir !